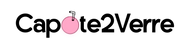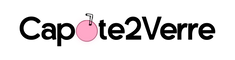Capote2Verres Blog
Capote2Verre-Blog
Prévention en soirée étudiante : les BDE se mobilisent contre la soumission chimique
<p><strong style="color:#FFACC8">BDE, écoles de commerce, ingénieurs</strong> : la prévention devient une priorité en cette rentrée 2025. Capote2Verre propose des <strong style="color:#FFACC8">solutions concrètes</strong> : capotes de verre, tests anti-drogue, ÉthyloCheck… avec <strong style="color:#FFACC8">-10 % pour les étudiants</strong>.</p>
Erfahren Sie mehrÉthylotest sans ballon : la solution préventive contre les excès d’alcool
Éthylotest préventif Capote2Verre : compact, sans ballon et précis (0,2 / 0,5 g/L). Un outil simple pour mesurer son alcoolémie, prévenir les excès et réduire les risques de soumission chimique en milieu festif.
Erfahren Sie mehrSoumission chimique par piqûre : gestes clés et protections efficaces
Les piqûres en soirée soulèvent de vraies inquiétudes dans les milieux festifs. Comment s’en prémunir ? Quels gestes adopter ? Découvrez les clés pour mieux comprendre ce phénomène et les solutions concrètes pour des événements plus sûrs.
Erfahren Sie mehrPrévention pour les jeunes : capote de verre, test CYD… Composez votre pack prévention complet
Prévention pour les jeunes : vous intervenez dans un lycée, une mission locale ou une association ? Composez votre pack prévention avec les capotes de verre et les tests CYD. Des outils simples et efficaces pour protéger, sensibiliser et agir concrètement. → Découvrir les produits
Erfahren Sie mehrCapote2Verre en pharmacie : rejoignez les officines engagées dans la prévention de la soumission chimique
Capote2Verre s’invite en pharmacie : devenez une officine de référence en prévention de la soumission chimique grâce à notre pack présentoir + capotes et nos posters d’information à afficher.
Erfahren Sie mehrBDE, Écoles, Universités : organisez votre rentrée sans risque grâce à Capote2Verre
Rentrée étudiante, week-end d’intégration, soirées à thème… Mettez la prévention au cœur de l’événement. Avec Capote2Verre, protégez vos participants de la soumission chimique tout en renforçant l’image de votre BDE.
Erfahren Sie mehrTest CYD : la solution ludique pour balayer tout doute lors de vos soirées
Découvrez le test CYD, l’allié prévention pour vos soirées : détection rapide, personnalisation dès 2000 pièces. Sécurisez et valorisez vos événements !
Erfahren Sie mehr20 ans de Sam : protéger la route et… les verres !
Sam fête ses 20 ans ! Sécurité routière et capote de verre : la double prévention à adopter lors des soirées festives.
Erfahren Sie mehrFake news sur la soumission chimique : démêlons le vrai du faux
La soumission chimique fait peur, et c’est compréhensible. Mais avec la peur viennent souvent les idées reçues, les fausses informations et les jugements infondés. Résultat ? Des victimes qui ne sont pas crues, une prévention moins efficace et des débats confus. Chez Capote2Verre, on remet les pendules à l’heure. On informe, on agit. "Ça n’arrive qu’en boîte de nuit" Faux.La soumission chimique peut survenir partout : soirées privées, festivals, bars, résidences étudiantes, et même dans des contextes familiaux ou professionnels.Ce n’est pas le lieu qui crée le danger, mais l’opportunité laissée à un agresseur. "C’est rare, ce sont juste des cas isolés" Faux.Les cas signalés ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. De nombreuses victimes ne portent pas plainte, par peur de ne pas être crues, de ne pas se souvenir, ou par culpabilité.En France, le nombre de signalements explose depuis plusieurs années, et les autorités reconnaissent qu’il s’agit d’un phénomène massif, non marginal. "Les victimes devraient faire plus attention à leur verre" Stop.Cette phrase relève du victim blaming (culpabilisation de la victime).Oui, il est important d’être vigilant·e, mais le problème, c’est l’agresseur, pas la victime.On ne dit pas à une personne cambriolée : « Tu n’avais qu’à mieux fermer tes fenêtres. »Alors pourquoi le faire dans le cas d’une agression chimique ? "C’est toujours du GHB dans les verres" Faux.Le GHB est le plus connu, mais loin d’être le seul. On retrouve aussi des benzodiazépines (Rohypnol, Xanax, Valium...), du clonazépam, des antihistaminiques, voire de l’alcool en dose massive.Les agresseurs utilisent ce qu’ils ont sous la main. Cette diversité rend le dépistage complexe. "C’est impossible de prouver qu’on a été drogué·e" Pas toujours.Il est vrai que certaines substances disparaissent rapidement de l’organisme, parfois en quelques heures.Cependant, il existe des structures spécialisées qui accompagnent les victimes, même sans preuve toxicologique.Et surtout, le témoignage d’une victime est toujours légitime. Ce qu’il faut retenir :La soumission chimique n’est ni un mythe, ni un fait divers isolé. C’est une réalité violente, trop souvent minimisée, ignorée ou déformée par des idées fausses. Déconstruire les fake news, c’est déjà un premier pas pour mieux protéger, mieux écouter, et surtout agir de manière juste et responsable. Parce qu’une seule victime, c’est déjà une de trop.Et que la vraie prévention commence par une information vraie.
Erfahren Sie mehrAlcools, drogues, soumission chimique : comprendre les différences
Tu crois savoir ce qu’est la soumission chimique ? Alcool, drogues, choix ou piège… Capote2Verre t’éclaire sur ce qui fait vraiment la différence : le consentement.
Erfahren Sie mehrVulnérabilité chimique : un danger invisible dans les lieux festifs
La nuit tombe, la musique monte, les verres s’entrechoquent. Dans ces moments delégèreté que sont les soirées, une menace insidieuse rôde de plus en plus souvent :celle de la vulnérabilité chimique. Encore peu connue du grand public, cette formed’agression repose sur l’exploitation de l’état de faiblesse d’une personneayant volontairement consommé de l’alcool ou une substance psychoactive, pourcommettre un acte de violence, souvent à caractère sexuel. À ne pas confondre avecla soumission chimique, qui consiste à droguer quelqu’un à son insu, la vulnérabilitéchimique s’inscrit dans un contexte où le consentement est rendu impossible à causede l’altération de la conscience de la victime.La vulnérabilité chimique est une forme d’agression sournoise. Elle est difficile àidentifier, à dénoncer, et à prouver. Pourtant, elle est loin d’être rare. D’après uneenquête menée par Santé Publique France en 2023, près de 13 % des femmesâgées de 18 à 25 ans déclarent avoir déjà été confrontées à une situation où elles sesentaient vulnérables sous l’effet de l’alcool, et où une personne a tenté de profiterde cet état. Ce chiffre grimpe à plus de 20 % dans le cadre de soirées étudiantes. La différence entre vulnérabilité chimique et soumissionchimique Il est essentiel de distinguer ces deux notions, souvent confondues. La soumissionchimique implique l’administration à l’insu de la victime d’une substance altérant soncomportement, sa vigilance ou sa conscience. Cela peut passer par des droguescomme le GHB, la kétamine, ou encore des somnifères introduits discrètement dansune boisson. Les effets sont généralement rapides, et peuvent aller de la perte demémoire à l’incapacité totale de réagir. La vulnérabilité chimique, quant à elle, repose sur un contexte différent : la substanceest consommée volontairement, souvent dans un cadre festif. Mais cetteconsommation crée un état d’affaiblissement physique ou psychologique quel’agresseur exploite intentionnellement. Il peut s’agir d’alcool, de cannabis, oud’autres substances psychoactives. Le point commun avec la soumission chimiquereste l’intention : profiter de l’altération de la conscience pour abuser de la victime.Il est important de souligner que la vulnérabilité chimique, bien que plus difficile àprouver juridiquement, ne dédouane en rien l’agresseur de sa responsabilité. Laconsommation volontaire d’alcool ne peut en aucun cas être considérée comme uneforme de consentement implicite. Une réalité banalisée, encore trop invisible Ce type d’agression survient souvent dans des contextes où la vigilance est relâchée: fêtes étudiantes, afterworks alcoolisés, concerts, bars. L’ambiance festive crée unclimat propice à la banalisation des comportements déplacés. Il arrive même quecertaines personnes justifient des actes inacceptables par la phrase tristementclassique : « elle avait trop bu ». Or, cette logique est dangereuse et culpabilisante.L’état d’ébriété n’annule pas les droits fondamentaux, et surtout, il ne justifie enaucun cas une agression.L’une des grandes difficultés dans la reconnaissance de la vulnérabilité chimique estqu’elle est moins spectaculaire que la soumission chimique. Il n’y a pas toujours deperte de connaissance ou de traces physiques. Pourtant, les conséquencespsychologiques sont souvent similaires : stress post-traumatique, sentiment dehonte, perte de confiance en soi, isolement social, anxiété, voire dépression. Des outils de prévention existent Face à cette problématique, il est indispensable de mettre en place des outils deprévention adaptés. La sensibilisation est la première étape : il faut que les jeunes,les étudiants, les professionnels de la nuit et du secteur événementiel soient formésà reconnaître et à agir face à ces situations.Certains dispositifs permettent aujourd’hui de limiter les risques. Parmi eux, on trouveles capotes de verre, qui permettent de protéger un verre contre toute intrusion desubstance étrangère. D’autres outils existent également, comme les tests dedétection de drogue dans les boissons, de type CYD (Check Your Drink), que l’onpeut utiliser en quelques secondes sur un verre suspect. Certains établissementsproposent également des systèmes d’alerte, des boutons discrets ou des mots decode à donner au personnel pour signaler une situation à risque. Pourquoi il faut nommer et visibiliser la vulnérabilité chimique Nommer un phénomène, c’est lui donner une réalité, et donc le rendre visible auxyeux de la société. Le terme vulnérabilité chimique doit entrer dans les discourspublics, dans les campagnes de sensibilisation, et surtout dans les réflexionsjuridiques. Il ne s’agit pas d’inventer une nouvelle catégorie de crime, mais dereconnaître que certains agresseurs exploitent volontairement un état de faiblessepour nuire à autrui. Le flou autour de cette notion ne doit plus servir d’excuse oud’écran à l’impunité.Les campagnes de prévention doivent également rappeler qu’une personnealcoolisée reste en droit d’être protégée. Le consentement ne peut être obtenu demanière valide lorsqu’une personne est sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue. Vers une culture du respect dans les lieux festifs La lutte contre la vulnérabilité chimique passe aussi par un changement culturel. Ilest temps de remettre la notion de consentement actif, clair et enthousiaste au cœur de toutes les interactions, quelles qu’elles soient. Que ce soit en soirée, dans un bar,sur un campus ou dans un festival, il est du devoir de chacun de veiller à la sécuritéde l’autre.Il ne s’agit pas de culpabiliser les victimes, ni d’interdire la fête, mais de créer unenvironnement où la vigilance collective devient une norme. Offrir un verre,raccompagner un·e ami·e, signaler un comportement douteux, ou tout simplementrester attentif à ce qui se passe autour de soi sont des gestes simples, maispuissants.
Erfahren Sie mehrLutte contre la soumission chimique : Sandrine Josso et Véronique Guillotin dévoilent 50 mesures essentielles.
En mai 2025, un rapport parlementaire signé par la députée Sandrine Josso (LesDémocrates) et la sénatrice Véronique Guillotin (Rassemblement Démocratique etSocial Européen) propose un ensemble de 50 recommandations pour lutter contre lasoumission chimique, un phénomène criminel encore trop méconnu, mais en forteextension. À travers cette initiative, les parlementaires souhaitent mettre en lumièrel'ampleur du problème et offrir des solutions concrètes pour protéger les victimes. Le contexte de l'affaire et la naissance du rapport Tout a commencé après l'affaire médiatisée de novembre 2023, où le sénateur JoëlGuerriau a été accusé d’avoir administré de la MDMA à la députée Sandrine Josso dansle but de commettre une agression sexuelle. Ce drame a révélé au grand jour l’existenced’un phénomène de soumission chimique de plus en plus répandu. Face à la prise deconscience collective, les parlementaires ont décidé de réagir et de formuler despropositions concrètes."Le fléau de la soumission chimique est souvent invisible, insidieux, et surtout ignorépar une grande partie de la population. Mais il touche de plus en plus de victimes,souvent sans qu'elles ne réalisent immédiatement ce qui leur arrive", expliqueSandrine Josso. Elle ajoute : "Il est de notre responsabilité de législateurs de protégernos concitoyens et de leur offrir les moyens de se défendre." Les 50 mesures : une feuille de route pour 2025 Dans leur rapport, Sandrine Josso et Véronique Guillotin proposent des mesures quivont de la prévention à la prise en charge des victimes, en passant par des réformeslégislatives et judiciaires. Parmi les 50 recommandations, voici celles qui devraient êtremises en œuvre dès 2025. 1. Campagne de sensibilisation nationale "Nous devons mettre en place une campagne de sensibilisation dès cette année pouralerter les jeunes et les adultes sur les dangers de la soumission chimique et sur lafaçon de s’en protéger", précise Véronique Guillotin. La campagne inclura destémoignages de victimes et des explications sur la manière dont les substances sontadministrées. 2. Renforcer les moyens pour les prélèvements toxicologiques Actuellement, les prélèvements toxicologiques sont souvent cruciaux pour prouverl’acte de soumission chimique. Cependant, les victimes peinent parfois à obtenir cesanalyses à temps. "Il est impératif que chaque hôpital, chaque centre de santé, disposedes équipements nécessaires pour effectuer ces tests rapidement", souligne SandrineJosso. 3. Éducation à la vie affective et sexuelle (EVARS) Le rapport propose d’intégrer l’éducation à la vie affective et sexuelle dans lesprogrammes scolaires, afin de mieux préparer les jeunes à reconnaître les signesd’abus et à comprendre les enjeux du consentement. "Les jeunes doivent savoir queleur corps leur appartient et que personne n’a le droit de leur imposer quoi que ce soit",déclare Véronique Guillotin. 4. Mise en place de référentiels pour l’accompagnement des victimes Le rapport recommande la création d'un référentiel par la Haute Autorité de Santé pourguider les professionnels de santé dans le dépistage et l’accompagnement des victimesde soumission chimique. "Les victimes doivent se sentir écoutées, soutenues et prisesen charge de manière professionnelle et bienveillante", insiste Véronique Guillotin. Un appel à la justice et aux réformes législatives Les parlementaires ont également souligné l'importance de réformer la législation pourrendre plus sévères les peines liées à la soumission chimique. Aujourd’hui, lalégislation considère la soumission chimique comme un précurseur au viol ou àl’agression sexuelle, mais elle reste insuffisamment dissuasive."Nous devons légiférer plus fermement pour que les auteurs de soumission chimiquesoient condamnés à des peines plus lourdes", plaide Sandrine Josso. "C’est unequestion de respect des droits fondamentaux des victimes. Nous devons leur offrir uneprotection maximale." Les victimes se manifestent : des voix qui résonnent Dans le rapport, plusieurs victimes de soumission chimique ont accepté de témoigneranonymement. L'une d’elles raconte : "Je ne me souviens de rien, sauf de m’êtreréveillée dans un état indescriptible. Si j’avais su, si j’avais eu les outils pour reconnaîtrece qui se passait, je n’aurais pas été prise au piège." Ce témoignage est loin d'être uncas isolé. De plus en plus de victimes se manifestent, mais le silence qui entoure cephénomène reste prégnant.Des associations de défense des droits des femmes, comme "Collectif Soyons Prêtes",ont salué la démarche des parlementaires. "Nous soutenons pleinement ce rapport, quiest un véritable pas en avant dans la lutte contre la soumission chimique. Il est temps que la société prenne conscience de l’urgence de la situation", a déclaré une porte-parole du collectif. L'avenir : des mesures concrètes pour une société plussûre Alors que l’Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à débattre du contenu de cerapport dans les mois à venir, l’objectif reste clair : protéger les victimes, éduquer lesgénérations futures, et offrir des solutions de prévention et de prise en charge adaptées.Pour Sandrine Josso, "la lutte contre la soumission chimique ne s’arrête pas àl’adoption de ces mesures. C’est un combat quotidien, un engagement commun."Véronique Guillotin conclut : "Il est de notre devoir de législateurs de garantir quechacun puisse vivre en toute sécurité, sans craindre de perdre le contrôle de soncorps."
Erfahren Sie mehr