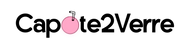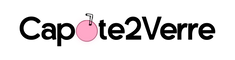La nuit tombe, la musique monte, les verres s’entrechoquent. Dans ces moments de
légèreté que sont les soirées, une menace insidieuse rôde de plus en plus souvent :
celle de la vulnérabilité chimique. Encore peu connue du grand public, cette forme
d’agression repose sur l’exploitation de l’état de faiblesse d’une personne
ayant volontairement consommé de l’alcool ou une substance psychoactive, pour
commettre un acte de violence, souvent à caractère sexuel. À ne pas confondre avec
la soumission chimique, qui consiste à droguer quelqu’un à son insu, la vulnérabilité
chimique s’inscrit dans un contexte où le consentement est rendu impossible à cause
de l’altération de la conscience de la victime.
La vulnérabilité chimique est une forme d’agression sournoise. Elle est difficile à
identifier, à dénoncer, et à prouver. Pourtant, elle est loin d’être rare. D’après une
enquête menée par Santé Publique France en 2023, près de 13 % des femmes
âgées de 18 à 25 ans déclarent avoir déjà été confrontées à une situation où elles se
sentaient vulnérables sous l’effet de l’alcool, et où une personne a tenté de profiter
de cet état. Ce chiffre grimpe à plus de 20 % dans le cadre de soirées étudiantes.
La différence entre vulnérabilité chimique et soumission
chimique
Il est essentiel de distinguer ces deux notions, souvent confondues. La soumission
chimique implique l’administration à l’insu de la victime d’une substance altérant son
comportement, sa vigilance ou sa conscience. Cela peut passer par des drogues
comme le GHB, la kétamine, ou encore des somnifères introduits discrètement dans
une boisson.
Les effets sont généralement rapides, et peuvent aller de la perte de
mémoire à l’incapacité totale de réagir.
La vulnérabilité chimique, quant à elle, repose sur un contexte différent : la substance
est consommée volontairement, souvent dans un cadre festif. Mais cette
consommation crée un état d’affaiblissement physique ou psychologique que
l’agresseur exploite intentionnellement. Il peut s’agir d’alcool, de cannabis, ou
d’autres substances psychoactives. Le point commun avec la soumission chimique
reste l’intention : profiter de l’altération de la conscience pour abuser de la victime.
Il est important de souligner que la vulnérabilité chimique, bien que plus difficile à
prouver juridiquement, ne dédouane en rien l’agresseur de sa responsabilité. La
consommation volontaire d’alcool ne peut en aucun cas être considérée comme une
forme de consentement implicite.
Une réalité banalisée, encore trop invisible
Ce type d’agression survient souvent dans des contextes où la vigilance est relâchée
: fêtes étudiantes, afterworks alcoolisés, concerts, bars. L’ambiance festive crée un
climat propice à la banalisation des comportements déplacés. Il arrive même que
certaines personnes justifient des actes inacceptables par la phrase tristement
classique : « elle avait trop bu ». Or, cette logique est dangereuse et culpabilisante.
L’état d’ébriété n’annule pas les droits fondamentaux, et surtout, il ne justifie en
aucun cas une agression.
L’une des grandes difficultés dans la reconnaissance de la vulnérabilité chimique est
qu’elle est moins spectaculaire que la soumission chimique. Il n’y a pas toujours de
perte de connaissance ou de traces physiques. Pourtant, les conséquences
psychologiques sont souvent similaires : stress post-traumatique, sentiment de
honte, perte de confiance en soi, isolement social, anxiété, voire dépression.
Des outils de prévention existent
Face à cette problématique, il est indispensable de mettre en place des outils de
prévention adaptés. La sensibilisation est la première étape : il faut que les jeunes,
les étudiants, les professionnels de la nuit et du secteur événementiel soient formés
à reconnaître et à agir face à ces situations.
Certains dispositifs permettent aujourd’hui de limiter les risques. Parmi eux, on trouve
les capotes de verre, qui permettent de protéger un verre contre toute intrusion de
substance étrangère. D’autres outils existent également, comme les tests de
détection de drogue dans les boissons, de type CYD (Check Your Drink), que l’on
peut utiliser en quelques secondes sur un verre suspect. Certains établissements
proposent également des systèmes d’alerte, des boutons discrets ou des mots de
code à donner au personnel pour signaler une situation à risque.
Pourquoi il faut nommer et visibiliser la vulnérabilité chimique
Nommer un phénomène, c’est lui donner une réalité, et donc le rendre visible aux
yeux de la société. Le terme vulnérabilité chimique doit entrer dans les discours
publics, dans les campagnes de sensibilisation, et surtout dans les réflexions
juridiques. Il ne s’agit pas d’inventer une nouvelle catégorie de crime, mais de
reconnaître que certains agresseurs exploitent volontairement un état de faiblesse
pour nuire à autrui. Le flou autour de cette notion ne doit plus servir d’excuse ou
d’écran à l’impunité.
Les campagnes de prévention doivent également rappeler qu’une personne
alcoolisée reste en droit d’être protégée. Le consentement ne peut être obtenu de
manière valide lorsqu’une personne est sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue.
Vers une culture du respect dans les lieux festifs
La lutte contre la vulnérabilité chimique passe aussi par un changement culturel. Il
est temps de remettre la notion de consentement actif, clair et enthousiaste au cœur
de toutes les interactions, quelles qu’elles soient. Que ce soit en soirée, dans un bar,
sur un campus ou dans un festival, il est du devoir de chacun de veiller à la sécurité
de l’autre.
Il ne s’agit pas de culpabiliser les victimes, ni d’interdire la fête, mais de créer un
environnement où la vigilance collective devient une norme. Offrir un verre,
raccompagner un·e ami·e, signaler un comportement douteux, ou tout simplement
rester attentif à ce qui se passe autour de soi sont des gestes simples, mais
puissants.